Warpstone - "Into the Phantasmancer Celestial Castle" (Album, 2014)
Tracklist :
01. The March - 04:13
02. Graveyard Addicted - 05:23
03. Into the Phantasmancer Celestial Castle - 06:10
04. Orange Moon - 05:23
05. Interlude - 01:59
06. Malevolent Intent - 03:13
07. The Virtuous and the Goatlord - 03:30
08. Emerald Anthem - 03:23
09. The Sleepwalker - 04:08
Extrait à écouter :
___________________________________
Tournis vertigineux face au cortège infernal d'yeux rouges, de tourelles surgissant d'entre les roches et les nuages, de longues plantes dont on ne saurait dire si elles sont arbres ou racines des murs les surplombant : nos sens sont déjà assaillis, notre souffle coupé par la simple vue de l'oeuvre de Paolo Girardi, une fois de plus chargé par les membres de Warpstone de la réalisation de l'artwork de leur album. La formation s'auto-désignant comme groupe de progressive occult metal est l'an passé revenu à la charge avec « Into the Phantasmancer Celestial Castle », qui propose un regard depuis les murs de cet édifice surgissant par fragments d'entre les hauteurs des pics rocailleux. Plongée tourbillonnante dans les iris de braise des boucs, incarnations du chaos gagnant peu à peu les pierres par des ronces enlaçant certains pans du château, ou levée des yeux vers les cieux éclatants et les délicats pavillons des trompettes du jugement dernier? Le prisme d'interprétation offert par ce dernier sera un outil précieux pour pénétrer dans l'univers de ce disque riche, contrasté, marqué par une esthétique de l'entre-deux et par une hésitation constante entre l'appel aérien de la rédemption et la tentation de la fosse des damnés.
Celle-ci s'impose pourtant sans concession apparente dans "Graveyard Addicted", morceau d'ouverture au riff grinçant inlassablement martelé avec intelligence, puisqu'il assure aussi bien la cohérence thématique du titre que sa constante évolution. Le tour de force principal est ici, tout comme dans le reste de l'album, cette habileté à se re-saisir régulièrement de l'attention de l'auditeur en mettant sous le feu des projecteurs de nouveaux visages de l'idée originelle et fondatrice du morceau. Cette gestion de la répétition, parfaitement efficace, permet un enchaînement souvent très naturel entre les diverses sections structurant chaque titre. Résultent de ce mode de construction des formes narratives par exemple évidentes sur les morceaux à personnages comme "The Virtuous and the Goatlord" ou "The Sleepwalker", formes qui dessinent rapidement un progressif au sens le plus littéral du terme, fondé sur l'emboîtement de fragments conférant chaque fois un élan neuf à la composition en variant subtilement cette dernière, la plupart du temps sans en oublier le fil conducteur.
Les musiciens de Warpstone parviennent donc à amener différents éclairages sur leurs morceaux sans tomber dans une segmentation totale de la structure, mais plutôt en misant sur un déploiement évolutif de leur musique, qu'ils parviennent à contraster et nuancer de manière plus fine que sur l'album précédent, « Daemonic Warpfire ». Ce progrès est notamment bien concrétisé dans l'utilisation de la guitare acoustique, qui n'était auparavant que l'actrice d'intermèdes calmes assez isolés, formant des parenthèses dans la composition. Désormais, elle est employée à des fins de coloration de l'environnement sonore, auquel elle est pleinement intégrée. Le dynamisme qu'elle confère à la fin de "The March", en s'associant à son homonyme électrique, est significatif à cet égard. Cependant, si l'écueil de la surexploitation des contrastes d'opposition directe est évité, les membres du groupe ont su repérer les instants précis où les revirements plus violents leur sont profitables. Le malin plaisir visiblement pris dans le positionnement de l'agressive "Malevolent Intent" immédiatement après l'"Interlude" rêveur mourant dans un souffle sourd mérite la mention, mais il ne résume certes pas la juste utilisation des brusques face-à-faces entre deux atmosphères ici faite. Une remarquable occurrence de ce procédé est à relever dans le morceau titre, au beau milieu duquel apparaît une section onirique avec un synthétiseur rappelant parfois celui d'un Oldfield grande époque (entendez « Ommadawn »), particulièrement dépaysante après un passage où l'instrumentation était lancée à pleine vitesse, sous l'impulsion d'une batterie endiablée. La dimension menaçante de cette incursion de musique aussi planante que troublée est en grande partie installée par le chant clair qui se fait dissonant, et par-là même presque provoquant.
Le chant clair, justement. S'il contribue, comme dans le premier album, à forger l'identité du groupe en faisant surgir des lignes psalmodiantes créant d'intéressants revêtements sonores, il pourrait peut-être faire l'objet d'une mise en avant plus prononcée au mixage. Il semble en effet toujours lointain, au point qu'il apparaît presque à l'écart du reste des instruments, sans réellement trouver de place de choix dans le design sonore des morceaux. Ce dernier, au-delà de sa relative stabilité tout au long de l'album, est néanmoins à l'occasion étayé par d'élégantes superpositions vocales, à l'image de la polyphonie solidement architecturée de "Emerald Anthem" ou encore de l'habillage de la fin de "The Virtuous and the Goatlord', couplant habilement un growl dans l'oreille droite et un chant plus proche du scream à gauche.
Ces mélanges, loin de se limiter aux parties vocales, bâtissent des atmosphères surprenantes de richesse, bien qu'elles ne s'éternisent jamais. Le type de maîtrise dont témoigne cet album pourrait conduire à adresser à Warpstone la même louange que celle formulée par Nietzsche à propos des Grecs anciens, qualifiés de "superficiels en profondeur" à la fin de la préface à la deuxième édition du Gai Savoir. Superficialité, sans connotation péjorative, par le primat du travail sur le fragment individuel plutôt que sur la conception globale de chaque composition (qui n'est pas pour autant inexistante) ; profondeur, par l'extrême précision de ce même travail de détail en permanence approfondi et ouvragé, qui est justement ce qui permet de renouer avec la sensation d'avancer, d'assister à une évolution au sein du morceau. L'opus est en ce sens un parfait écho à sa couverture picturale, où sont alliés déferlement de détails et pensée d'ensemble, que ce soit dans la verticalité reliant la lumière céleste aux ténèbres de l'abîme, ou dans la construction de la moitié supérieure de l’œuvre en triptyque opposant le jour et la nuit. Dans l'une et l'autre perspective, le fameux château céleste est un intermédiaire, entre paradis et enfer, rédemption et damnation, mais aussi veille et sommeil. Tiraillé dans les jeux d'ombres, l’œil à la source d' « Into the Phantasmancer Celestial Castle » ne peut qu'être pris entre deux eaux, et se réfugier dans des états transitoires tels que celui, bien entendu, du rêve, ou encore du somnanbulisme ("The Sleepwalker") ; l'hésitation entre l'homme vertueux et le seigneur des boucs, à l'apparence clairement maléfique ("The Virtuous and the Goatlord"), n'a pas non plus d'autre source. Cette esthétique de l'entre-deux fait tout le charme de cet album aux textures mixtes, refusant de trancher entre les différentes dispositions d'esprit et de se limiter à des constructions manichéennes ; aucun passage n'est complètement apaisé, aucun n'est entièrement privé de luminosité. La partie inférieure de l'artwork n'est d'ailleurs elle-même pas totalement épargnée par le bain de lumière la surplombant.
Il est aisé d'imaginer la tension découlant inévitablement d'une telle ambiguïté thématique. Cependant, les ressources de cette tension ne sont pas toujours exploitées autant qu'elles pourraient l'être. Plusieurs morceaux s'effacent en effet sur des motifs encore troublés, sous pression, qui laissaient pourtant entrevoir un large potentiel pour prolonger le titre de manière tout à fait justifiée. Les compositions reprennent toujours leur élan, mais ce dernier est parfois abandonné en cours de route, ramenant certaines trouvailles à de simples éléments décoratifs. Sont ici visées les clôtures de "The March" ou encore de "Malevolent Intent" ; la seconde aboutit malheureusement à un ralenti qui n'est que conclusif, alors qu'il laissait espérer un revirement instrumental séducteur. Ce type de déception conduit par ailleurs à l'abrègement global des morceaux, dont seul l'éponyme atteint les six minutes, alors que deux titres dépassaient les huit minutes sur l'album précédent. On conviendra qu'il est dommage d'avoir à faire un tel reproche à un groupe de progressif...
Ces dernières considérations n'avaient évidemment pas pour objectif d'éclipser les nombreuses qualités d' « Into the Phantasmancer Celestial Castle », dont l'effet principal sur l'auditeur reste celui d'une noyade dans la fusion d'une forme d'onirisme inquiétant à souhait et de l'habituelle violence chère aux penchants occultes du groupe, épanoui dans des riffs étirés, rampants, insidieux. Avoir su mêler ce dernier aspect de leur musique à une composition colorée et sans cesse renouvelée, voilà probablement la plus belle réussite de Warpstone dans ce dernier album.
___________________________________
Auteur : Marion
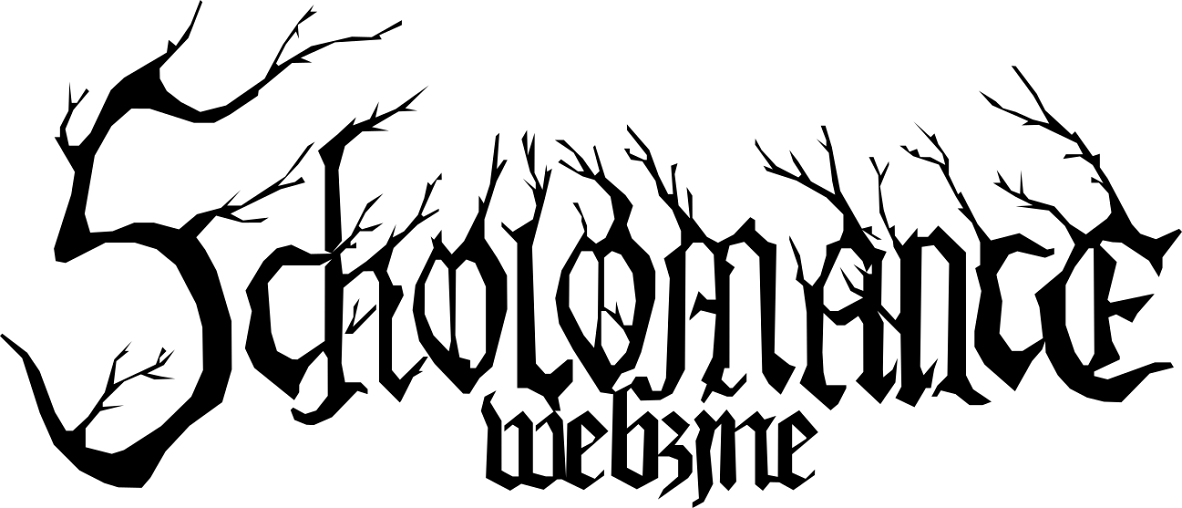


Commentaires
Enregistrer un commentaire